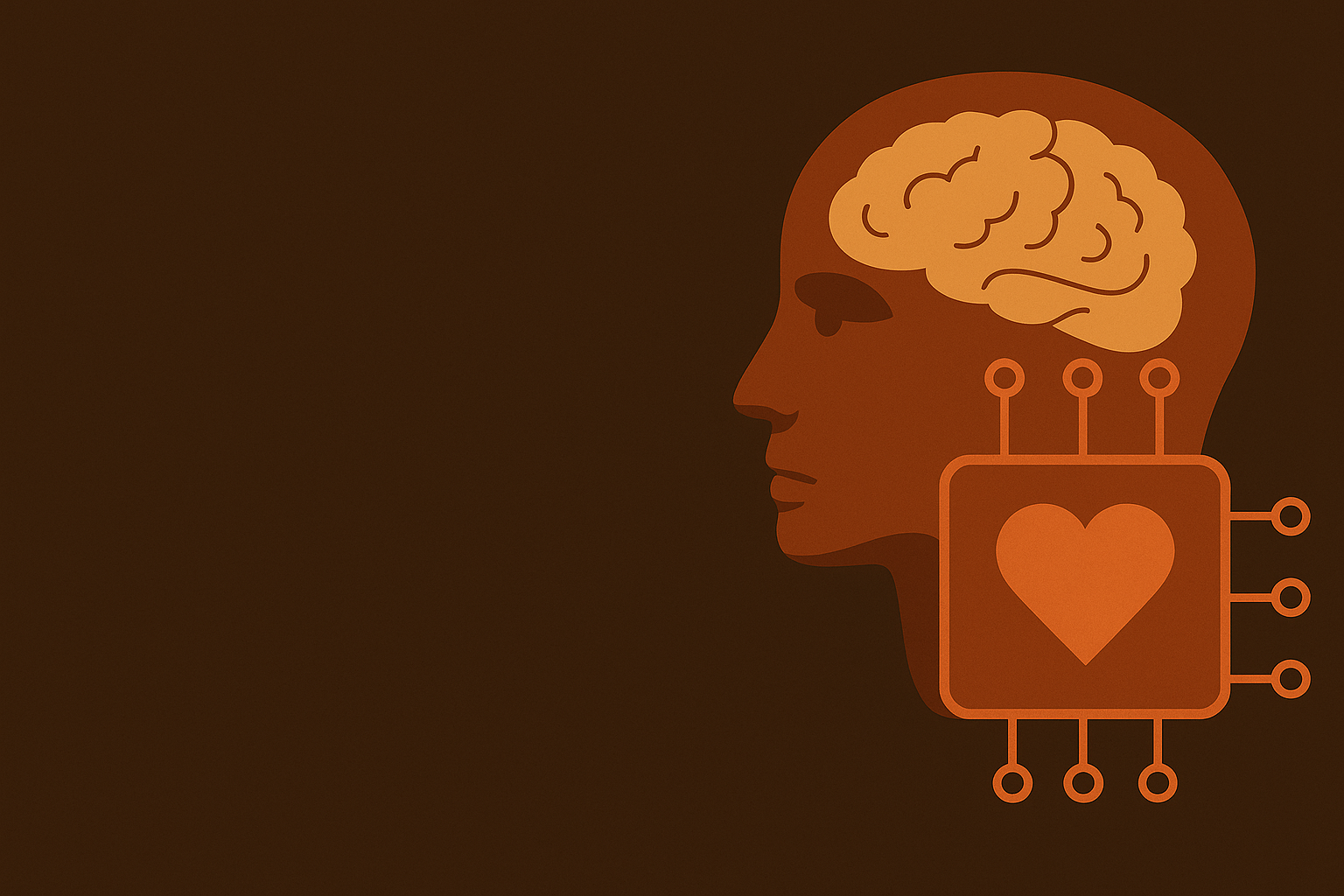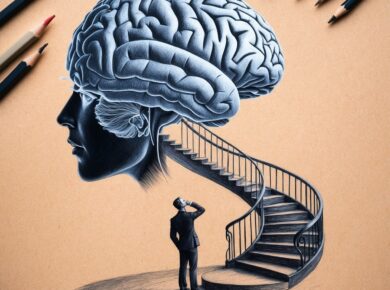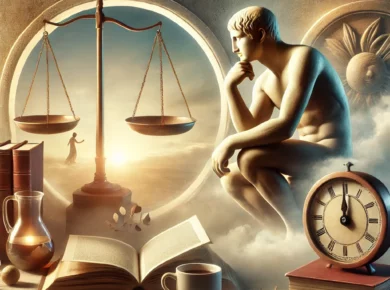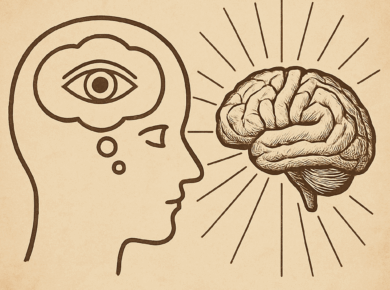Dans un monde où tout semble à vendre – nos données, notre attention, notre temps –, l’esprit humain demeure l’un des derniers sanctuaires de souveraineté individuelle. Même quand les circonstances extérieures nous échappent, il reste une zone d’autonomie que nul ne peut violer sans notre consentement : notre subjectivité. Nos pensées, nos sentiments, nos intuitions : ils nous appartiennent, à partager ou à taire selon notre propre volonté.
Pourtant, ces dernières années, les géants de la Silicon Valley ont entamé un projet aux allures d’invasion invisible : s’introduire dans l’intimité de nos émotions pour en faire une ressource exploitable, une matière première à monétiser. Que nous en soyons conscients ou non, que nous y consentions ou pas, l’extraction émotionnelle est en marche.
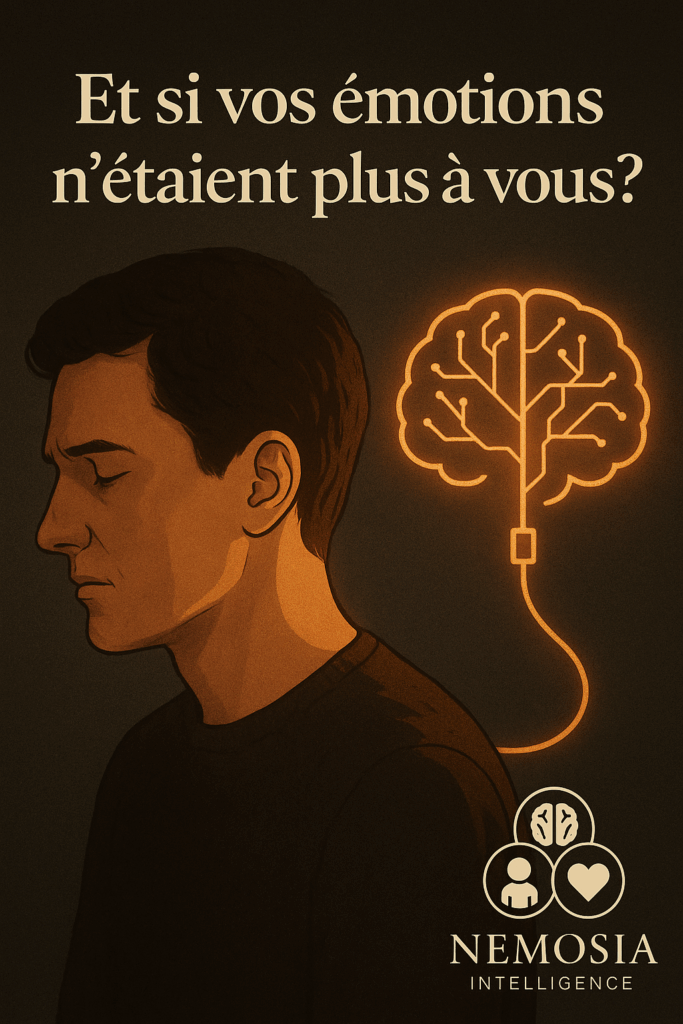
À l’origine de cette entreprise se trouve une nouvelle foi technologique. Une croyance selon laquelle les émotions humaines se réduisent à six états fondamentaux : la colère, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse, la surprise… Un dogme aussi simpliste que séduisant pour les ingénieurs cherchant à traduire l’invisible en algorithmes.
Ainsi, des logiciels ont été conçus pour décrypter nos visages, traquer les micro-expressions, scruter l’angle d’un sourcil ou la tension d’une lèvre. Des milliers de caméras, désormais omniprésentes dans nos espaces publics et privés, sont couplées à des technologies de reconnaissance faciale capables d’interpréter nos humeurs en temps réel. Ces systèmes, fruits des ambitions de sociétés parmi les plus puissantes de l’histoire, prétendent collecter un flux constant de données émotionnelles, créant des empreintes numériques de notre vie intérieure comme s’il s’agissait d’actifs financiers.
Les promoteurs de cette technologie affirment, sans ciller, avoir pénétré les derniers replis de notre vie privée. Ils se vantent d’avoir piraté les mystères du cœur humain.
Mais ont-ils réellement réussi ? Notre humanité est-elle aussi vulnérable, aussi prévisible qu’ils le prétendent ?
L’illusion de la maîtrise
À y regarder de plus près, la prétention des maîtres du numérique s’effondre sous le poids de l’évidence. Leur système, loin d’être une avancée scientifique, repose sur une théorie périmée : celle des émotions universelles, popularisée dans les années 1960. Une théorie depuis longtemps contredite par les découvertes les plus récentes en psychologie et en neurosciences.
Le simple bon sens suffit à en montrer les limites. Chacun de nous sait, par expérience, que ses émotions ne se limitent pas à six catégories préfabriquées. Nous ressentons une infinité de nuances : la nostalgie, l’amertume douce, la sérénité inquiète, l’espoir fragile… autant de subtilités qu’aucune caméra ne saurait pleinement capter.
Et pourtant, face à l’arsenal technologique et aux données massives, nous restons souvent impressionnés. Les chiffres fascinent, comme s’ils étaient l’expression d’une vérité absolue. Mais les données peuvent être fausses, biaisées, ou interprétées de façon erronée. Les modèles d’IA émotionnelle – qu’il s’agisse de ceux d’Affectiva, Face++, Apple, Google, Amazon ou Meta – ne lisent pas les émotions, ils les devinent à partir de signes extérieurs réducteurs, privés du contexte et de la profondeur qui donnent sens à l’expérience humaine.
L’émotion n’est pas une mécanique visible à l’œil nu. Elle est vécue de l’intérieur, intime, indissociable de la conscience. Aucune machine, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut ressentir. Et sans ressenti, il n’y a pas de compréhension authentique.
La richesse de notre vie intérieure
Ne nous laissons pas réduire à des objets à analyser, à scanner, à monétiser. Nos vies émotionnelles sont bien plus vastes, plus précieuses, plus nuancées que ce que les algorithmes peuvent imaginer.
Certes, certaines personnes ont du mal à identifier et nommer leurs émotions. Les psychologues appellent cela une faible granularité émotionnelle. Ces individus perçoivent leurs émotions de manière grossière, comme à travers un verre dépoli. Ils ressentent “de la tristesse”, “de la colère”, ou “de la joie”, sans en distinguer les multiples variations. Leur monde affectif est pixelisé, flou, appauvri.
À l’opposé, d’autres font preuve d’une granularité émotionnelle élevée. Ils perçoivent la texture fine des émotions humaines. Ils peuvent faire la différence entre la mélancolie et la nostalgie, entre l’irritation et la frustration, entre la joie sereine et l’euphorie imprudente. Leur vocabulaire émotionnel est vaste, leur capacité de discernement aiguisée. Et cette richesse intérieure se traduit dans leur bien-être psychologique, leur santé globale, et la qualité de leurs relations sociales.
Plus nous sommes capables de nommer nos émotions avec précision, plus notre expérience humaine devient riche et profonde. À l’inverse, une vision simplifiée appauvrit notre subjectivité, nous rendant plus manipulables, plus prévisibles… et donc plus exploitables.
Réapprendre à sentir
Dans une époque où l’on tente de standardiser l’humain à coup de données, résister passe par un geste simple mais fondamental : revendiquer notre complexité émotionnelle. Cultiver notre sensibilité. Développer notre vocabulaire affectif. Enseigner à nos enfants à dire non seulement “je suis triste”, mais “je me sens abandonné”, “je suis envahi d’une douce mélancolie”, ou “je ressens une joie calme et pleine”.
Face aux machines, face aux marchés, face à la tentation de réduire l’humain à ce qui est mesurable, nous avons un outil précieux : notre capacité à vivre l’émotion dans toute sa densité. Un territoire que nul n’a encore conquis. Un langage que seuls les êtres vivants peuvent parler.