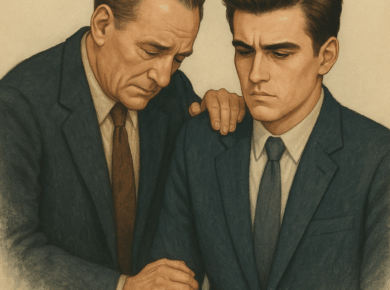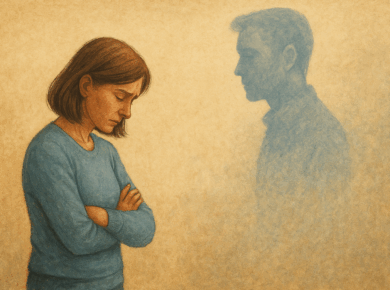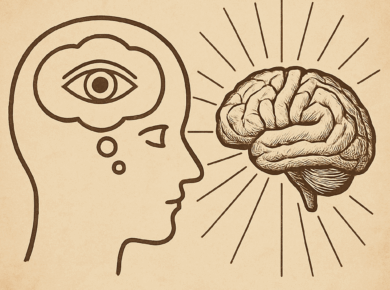L’aveuglement amoureux
Quand on aime intensément, qu’on court après quelqu’un depuis des années, qu’on se bat pour faire survivre une relation à bout de souffle, ou qu’on souffre d’un amour abandonné depuis longtemps, il est une question que l’on oublie presque toujours de se poser :
La personne que j’aime… est-elle gentille avec moi ?
La réponse, bien souvent, est déconcertante. Non. Cette personne que nous idéalisons, que nous poursuivons, à qui nous pensons à toute heure, n’est pas particulièrement douce, attentive ou bienveillante.
Elle nous ignore parfois, répond à peine à nos messages, oublie notre anniversaire, préfère ses amis à notre compagnie, ou se montre même condescendante. Pourtant, nous persistons, pleins d’amour, de passion, de dévouement.
Pourquoi aimons-nous ceux qui ne sont pas bons pour nous ? Pourquoi acceptons-nous l’absence, l’indifférence ou le mépris, en pensant qu’il s’agit encore d’amour ?
L’amour mal appris : une mémoire affective déformée
La réponse se trouve dans notre passé. Plus précisément, dans notre enfance émotionnelle.
Certaines personnes ont vécu une situation tragique, mais fréquente :
- Elles auraient dû être aimées.
- Mais elles ne l’ont pas été, ou pas de manière stable et sécurisante.
Alors, pour survivre psychiquement, elles ont associé l’amour à l’absence, au doute, au silence, à l’effort unilatéral. Elles ont appris à ne pas s’attendre à la tendresse, à justifier l’indifférence, à prendre la faute pour elles. Cette association est devenue inconsciente, mais tenace.
Dès lors, à l’âge adulte, une voix intérieure leur chuchote :
« Si tu veux être aimé, tu dois faire plus. »
« S’il ne répond pas, c’est toi qui es trop. »
« L’amour, c’est compliqué, incertain, parfois cruel. »
Et elles s’attachent aux personnes distantes, incohérentes, insensibles – non pas malgré leur cruauté, mais à cause d’elle. Parce que cette cruauté leur est familière.
Le prix du silence intérieur
Cette logique dévastatrice empêche des millions de personnes de reconnaître leur propre souffrance. Elles ne se demandent même plus :
« Suis-je heureux(se) dans cette relation ? »
« Cette personne prend-elle soin de moi ? »
« Est-ce que je me sens en sécurité à ses côtés ? »
Elles persistent, espèrent, redoublent d’efforts, mendient l’attention. Leurs besoins, leur dignité, leur paix intérieure passent au second plan.
Ce que la psychologie de l’attachement nous apprend
La théorie de l’attachement (Bowlby, Ainsworth) démontre que notre modèle amoureux est souvent calqué sur la qualité de la relation à nos figures parentales. Un attachement insécurisant – évitant ou anxieux – favorise les relations où l’on tolère l’intolérable, car l’amour a toujours été instable.
La neuroscience affective souligne aussi que la répétition des comportements maltraitants ou négligents altère notre régulation émotionnelle. Le rejet répété abîme les circuits neuronaux du plaisir, du lien et de la confiance.
Ce que l’on a enduré devient ce que l’on croit mériter.
Un critère oublié : la bonté
Nous devons dire les choses clairement :
La seule base légitime d’une relation, c’est la bonté.
Non pas la beauté, l’intelligence, le charisme ou la rareté. Mais la capacité de l’autre à nous écouter, à nous rassurer, à être présent émotionnellement, à prendre soin de nous.
Si cette personne :
- Ne te répond pas rapidement,
- Privilégie systématiquement d’autres personnes,
- Ignore tes douleurs,
- Te trouve “trop” sensible,
- Se montre incohérente ou distante,
… alors elle n’est pas un partenaire amoureux, mais un reflet vivant d’un traumatisme ancien.
L’amour ne doit pas être une guerre à mener, mais un refuge à retrouver.
Une phrase à retenir : n’aime que les gens gentils
Cela peut sembler naïf. Pourtant, c’est une vérité psychologique et existentielle. Une relation saine se fonde sur :
- La réciprocité
- La sécurité émotionnelle
- La clarté des intentions
- L’engagement mutuel
Tout le reste, c’est de la projection, du fantasme, du replay d’une blessure.
Tu as le droit d’aimer. Tu as le droit d’être aimé. Mais tu n’as pas à lutter pour mériter de l’attention.
Invites de journalisation : Revenir à la clarté affective 📝
- Est-ce que la personne que j’aime est gentille avec moi ?
- Que ressens-je après une journée passée avec elle ? Soulagé ? Anxieux ? Vide ?
- Est-ce que je peux lui parler de mes angoisses ? M’écoute-t-elle ?
- Ai-je tendance à me justifier ou à m’excuser d’exister ?
- À quoi ressemble l’amour dans mes souvenirs d’enfance ?
- Qui m’a appris à aimer sans recevoir ?
- Est-ce que j’associe la douleur à la preuve d’un lien profond ?
- Quelle est ma peur si je mets fin à cette relation ?
- Que dirais-je à un(e) ami(e) dans ma situation ?
- Est-ce que je me suis déjà senti aimé pour ce que je suis, sans effort ?
- Qu’est-ce qu’une personne vraiment aimante ferait à ma place ?
- Est-ce que je me sens respecté(e) dans cette relation ?
- Est-ce que je me sens libre d’être moi-même ?
- Ai-je déjà ressenti une joie paisible, douce, aimée, en amour ? Quand ?
- Suis-je en train de répéter un vieux scénario de rejet ou d’humiliation ?
Un message à retenir : Aimer, c’est se respecter
Nous ne devrions pas avoir à prouver notre valeur pour mériter une place dans le cœur de quelqu’un. L’amour n’est pas un trophée à gagner. C’est une tendresse réciproque, une bienveillance constante, une douceur sans effort.
Alors, posons la vraie question :
Est-ce que je suis aimé comme j’aimerais qu’un jour on aime mon enfant ?
Si la réponse est non… il est peut-être temps de choisir la seule forme d’amour qui ne trahit jamais : l’amour de soi.