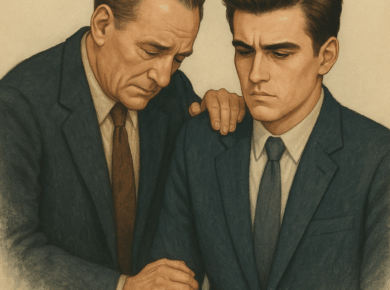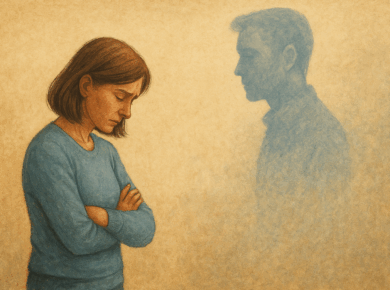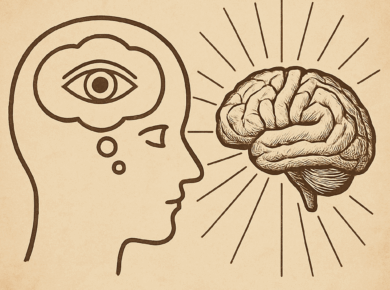L’un de nos comportements les plus déroutants est notre tendance, dans nos relations, à fuir la chaleur et l’affection si naturellement désirées. Face à une personne qui semble nous apprécier profondément, qui nous sourit tendrement dès que nous entrons dans la pièce et s’intéresse aux détails de notre vie, certains d’entre nous peuvent réagir de manière extrêmement contre-intuitive : en se sentant nauséeux et (avec le temps, probablement) en fuyant.
Pour comprendre ce type d’évitement émotionnel, on peut faire une analogie avec la nourriture. Imaginons une personne ayant grandi dans un environnement pauvre et soumis à un régime alimentaire sévère : elle n’avait d’autre choix que de s’habituer à des repas très légers. La seule façon de survivre était de n’avoir besoin de presque rien.
On pourrait supposer que, face à l’abondance, cette personne chercherait avidement à rattraper le temps perdu. Mais c’est bien le contraire qui se produit. Son système digestif, adapté à la rareté, ne peut assimiler la richesse qui s’offre à elle. La simple vue d’une assiette pleine peut générer de l’anxiété ; elle peut tomber malade face à l’abondance qu’elle désirait depuis si longtemps.
De même, en amour, ceux d’entre nous qui ont grandi dans des foyers où l’affection était sévèrement rationnée ont peut-être appris à ne pas exiger grand-chose des autres. Lorsqu’un partenaire s’intéresse énormément à notre journée, nous pouvons nous sentir étouffés plutôt qu’aimés. Lorsque quelqu’un veut passer toutes ses soirées avec nous, nous pouvons nous sentir piégés plutôt que désirés. Lorsque notre partenaire exprime son admiration, nous pouvons ressentir de l’inadéquation plutôt que de la satisfaction. Si l’on nous parle de mariage, notre première tentation peut être de flirter avec un ex. Notre malaise est un héritage central et un indicateur de notre manque.
Si nous acceptons que notre situation n’est pas un signe de malveillance, mais simplement le résultat d’une éducation mélancolique, nous trouverons peut-être un jour le courage d’expliquer la situation à notre partenaire (et d’abord, bien sûr, à nous-mêmes). Nous pouvons, sans honte, apprendre à notre bien-aimé que la plus grande gentillesse qu’il puisse faire pour nous est de ne pas être trop gentil avec nous, ou du moins pas trop tôt ; la plus généreuse serait de ne pas être trop généreux. Nous désirons son amour, c’est certain, mais nous en avons besoin à petites doses et non d’un coup. Nous avons besoin de temps pour nous, il ne faut pas trop de câlins, les compliments doivent être espacés. Nous apprécions sa gentillesse, il suffit de la prendre avec précaution.
Comprendre pourquoi l’amour doit être dosé ainsi aide notre partenaire à éviter de se sentir insulté, de se mettre en colère et, éventuellement, de recourir à des descriptions péjoratives de notre état d’évitement (phobie de l’engagement, peur de l’intimité, etc.). Nous pouvons tous deux savoir que notre façon d’aborder l’amour était, au départ, une adaptation très logique et intelligente à des conditions de manque affectif que nous n’avions pas choisies – et cela n’a rien à voir avec la méchanceté ou la pathologie.
En même temps, plus nous comprenons la genèse de notre sentiment d’être dépassé, plus nous finirons par percevoir que notre prudence a fait son temps. Nous pourrons peut-être supporter l’extase et la plénitude de l’amour mutuel, et nous n’aurons peut-être plus besoin de nous protéger si assidûment de ce qui nous nourrit et nous guérit.